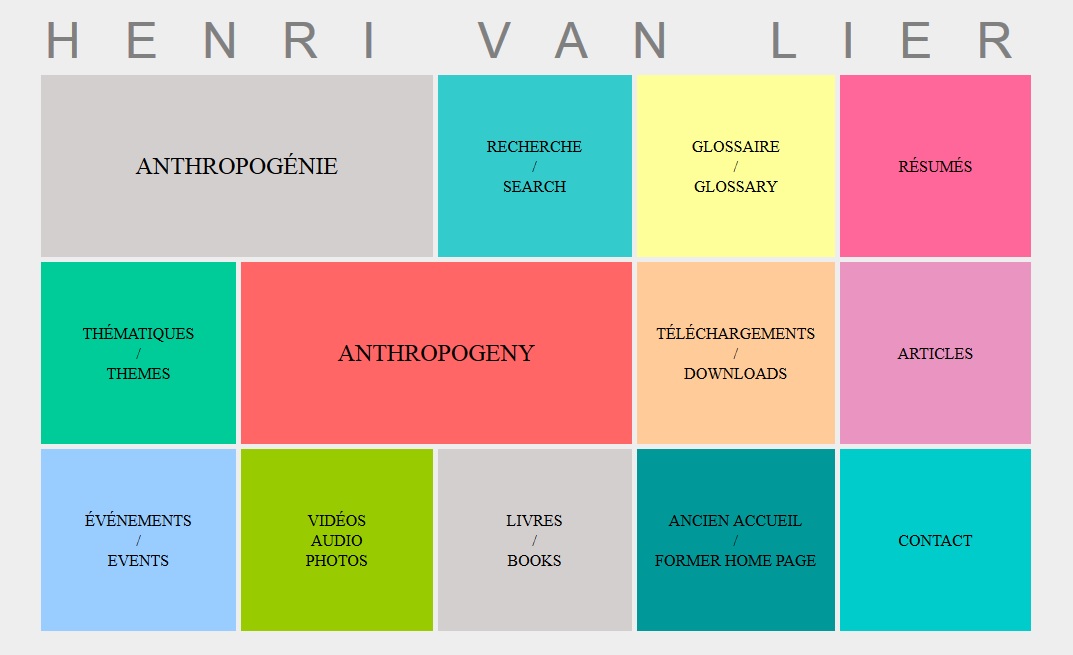Axe 1 - Rapport entre Signes et Technique
.jpg)
Henri Van Lier considère que la technique est partout et toujours première chez les humains.
Et, il avance l’hypothèse qu’Homo (Habilis, Neandertal, etc.) serait devenu technicien parce qu’il a eu la « chance évolutionniste » de disposer d’un corps particulier (redressé, segmentarisant, etc.) qui le prédisposait à devenir technicien, et plus tard sémioticien.
Que nous disent les recherches les plus récentes à ce sujet ? De quelles définitions de la technique disposons‐nous, valables aujourd’hui, mais aussi dès l’origine d’Homo ?
Pour le volet sémiotique, rappelons qu’Henri Van Lier considère les signes comme des segments d’un genre particulier. A la différence des segments techniques, ils n’ont aucun rôle opérationnel. Leur rôle se limite à thématiser (à mettre en ressaut, à désigner) d’autres segments d’univers.
Plusieurs chapitres d’Anthropogénie, l’oeuvre principale d’Henri Van Lier, sont consacrés à l’analyse des différents types de signes inventés par Homo technicien. Parmi ceux‐ci on trouve notamment les indices, les index, les effets de champs, les images, les langages, mais aussi les tectures et les écritures. Existe‐t‐il d’autres manières plus récentes ou pertinentes de définir et d’identifier les signes ?
Au cas par cas, ces ensembles de « signes » peuvent‐ils devenir porteurs de « sens » ?
La question centrale sera ici de savoir si les « signes » et le ou les « sens » qui en découlent peuvent prendre consistance hors d’un milieu préalablement technicisé, et si oui, comment ?
Axe 2 - Origine et devenir des Langages
.jpg)
Notre champ d’investigation sera celui des langages parlés par Homo, ainsi que celui des langages produits par certaines machines que nous appellerons « machines conversationnelles ».
Les autres moyens de communication, et notamment ceux des animaux, ne seront pas abordés ici, si ce n’est marginalement.
Concernant l’origine des langages, une des questions clé sera de savoir comment ils ont pu émerger et « signifier » quelque chose au cours de l’interminable période où Homo disposait d’un organe vocal à peine plus précis que celui d’un chimpanzé ? Notre langage moderne, rappelons‐le, est âgé de 80.000 ans à peine. Que permettait le langage rudimentaire qu’Homo a probablement pratiqué pendant les 99% du temps [sept millions d’années] qui le sépare de ses cousins chimpanzés ? Peut‐on, comme Henri van Lier, affirmer que ce langage ne pouvait acquérir de signification (signifier quelque chose), que dans un milieu préalablement technicisé, disposant d’une syntaxe fournie par les « circonstances » ?
Que dire ensuite des langages produits par les machines. Nos assistants vocaux ne sontils pas sur le point de soutenir de véritables conversations ? Ces langages apportent‐ils quelque chose de nouveau ? Sont‐ils limités au domaine de la « signification » (non ambigüe) ou peuventils s’étendre au domaine du « sens » et de ses multiples interprétations ?
Axe 3 - Les images sont-elles toujours sémiotiques ?
.jpg)
Jusqu’à l’invention récente de la photographie, les images artificielles étaient partout et toujours tracées par Homo. Il s’agissait de segments (portions) d’univers n’ayant d’autre objet que de thématiser d’autres segments d’univers. Et à ce titre, ces images tracées constituaient toujours des « signes ».
Mais, désormais, les photos, les vidéos et autres images granulaires ne sont plus tracées par la main de l’homme. Peut‐on considérer qu’une empreinte photo ou vidéo prise au hasard par un automate est aussi un « signe » ? L’est‐elle plus qu’une empreinte de dinosaure laissée dans la boue il y a 60 millions d’années ? Que disent les sémioticiens à ce sujet ?
A partir de quand une image inexplicable prise par un télescope, ou un flux incessant d’images prises par une machine acquièrent‐ils les propriétés des « signes », et deviennent‐ils porteurs de « signification » ou de « sens » ?
Axe 4 - Les machines peuvent-elles produire des signes, voire du sens ?
.jpg)
Lorsqu’une machine traduit automatiquement des textes, et construit elle‐même les glossaires et les règles syntaxiques qu’elle utilise pour ses traductions, nous sommes face à ce que nous pourrions appeler des « textes calculés ». Mais il n’y a pas que les textes qui peuvent être calculés. La plupart des images médicales le sont aussi. Et toutes les réponses à nos requêtes sur les moteurs de recherche sont des pages calculées (tri des résultats, extrait des phrases pertinentes).
Peut‐on parler alors de « signes calculés » ?
La notion même de signe ne doit‐elle pas être repensée à l’aune de ces évolutions ? Les signes font‐ils encore signe quand ce sont des machines qui les manipulent ou les formulent ?
Les « signes calculés » viennent‐il s’ajouter simplement à la collection des « signes » existants (indices, index, etc.), ou bien s’agit‐il de phénomènes nouveaux qui appellent de nouvelles définitions ?
Lorsqu’un drone attribue automatiquement des « signatures » aux membres d’une population afghane et identifie (qualifie) certains d’entre eux comme des cibles à « neutraliser », que deviennent les notions de « signe », de « signification » et de « sens » ?
L’intelligence artificielle, prise au sens large, nous conduit à reposer la question des « signes » et du « sens ». Peut‐on considérer qu’une machine est capable de produire des « signes » et du « sens » ?
Publics concernés
Philosophes de la Technique
Sémioticiens
Sciences du langage
Ingénieurs Numériques - IA
Macro-historiens
Anthropologues
Propositions de communication
Les propositions de communication, comprises entre 250 et 350 mots, assorties d’un bref CV de leur auteur, seront à envoyer à colloque2019@anthropogenie.com
avant le 30 juin 2019.
Format des communications
Chaque présentation se déroulera en 30 minutes. Elle sera suivie de 15 minutes de questions / réponses.
Un diaporama de présentation sera vivement souhaité.
La salle sera équipée d’un vidéo projecteur, de deux écrans de rappel pour le fond de la salle, et d’une sonorisation.
Document de travail
Un document de travail (sources documentaires, bibliographie, méli-mélo de sujets envisageables, etc.) pourra être obtenu sur simple demande à la même adresse colloque2019@anthropogenie.com
Sélection des interventions
Le Comité Scientifique évaluera la pertinence scientifique des interventions.
Le Comité Organisateur évaluera leur pertinence par rapport au thème anthropogénique du colloque.
Des allers-retours avec les organisateurs seront possibles et souhaitables.